- c18
- Publications
- Beckford
- Du Châtelet
- Graffigny
- Grimm
- Linnaeus
- Raynal
- Voltaire
- Bibliothèque
- Corrections et additions
- Bibliographie
- Éditions collectives
- Descriptions bibliographiques
- Œ48D L'édition Walther de 1748-1754
- Œ48D Les corrections à l'édition Walther de 1748-1754
- Œ48R L'édition Machuel de 1748
- H48R1 et H48R2 L'édition Machuel de La Henriade de 1748
- Œ50 L'édition Machuel de 1750
- Œ51 L'édition Lambert de 1751
- Œ52 L'édition Walther de 1752-1770
- Œ64R L'édition Machuel de 1764
- L'édition en cours
- Secrétaires et copistes
- Textes
- Journaux
- Yverdon
- Atelier du Livre
- Fonds Voltaire
- Société Voltaire
- Voltaire à Ferney
- Contact
ISSN 2271-1813
...
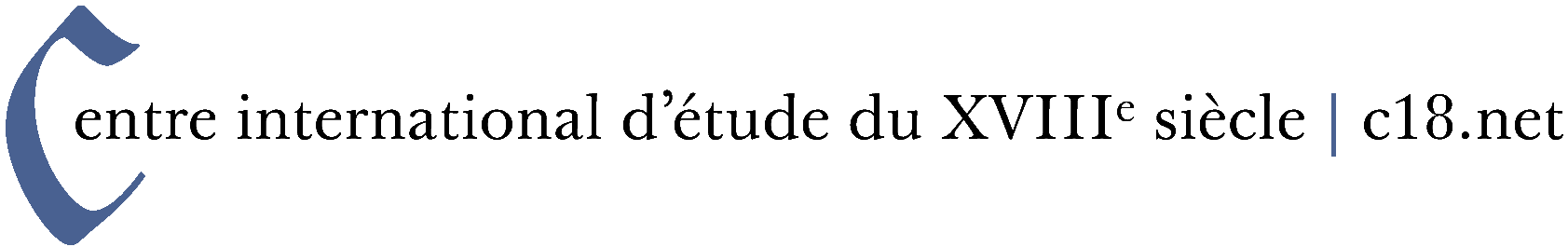
Préface de Roland Mortier
Voici un monument – de savoir, de passion, mais aussi de rigueur. Un monument au passé de l’Europe, à la splendeur des Lumières, à la richesse de la culture française et à son large épanouissement. Pour tous ceux qui bénéficient de cet héritage, la sortie du premier volume de l’imposante Correspondance littéraire est un véritable événement. Il convient de saluer sa publication et de dire après Cicéron: «habeo in manibus magnum opus». Quiconque souhaite pénétrer au cœur même de ce qui fait la singularité des Lumières devra s’y référer ou s’y promener au hasard d’une lecture.
La Correspondance littéraire est certes l’ouvrage majeur de Friedrich Melchior Grimm, mais elle est aussi le fruit du travail d’un collectif qui réunissait Louise d’Épinay, Diderot et plus tard Jacob Heinrich Meister, c’est-à-dire un Allemand, deux Français, un Suisse, sans compter quelques collaborateurs occasionnels. On peut y voir légitimement une audacieuse entreprise internationale, européenne à la fois par l’origine de ses créateurs et par l’extension de ses abonnés. La Correspondance constitue par excellence un révélateur de ce que fut l’esprit européen au siècle des Lumières.
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la France est devenue de fait le noyau culturel de l’Europe et on a pu parler à l’époque même d’une «Europe française» dont Paris serait la capitale et le foyer. Aucune ville du continent n’exerçait un rayonnement aussi intense et un tel pouvoir d’attraction. Londres était devenue incontestablement un des centres économiques du monde, mais c’est en Écosse que fleurissaient la philosophie, l’esthétique et l’économie politique. L’Allemagne, où la Prusse commençait à s’affirmer contre la Saxe et l’Autriche, n’était encore qu’un agrégat de principautés, de villes libres, de territoires religieux que seule la langue unifiait quelque peu, mais où la vie culturelle se situait tantôt dans des villes comme Hambourg et Francfort, tantôt dans les universités protestantes où s’affirmaient déjà la rigueur scientifique et l’esprit de méthode, et dont Grimm sera un pur produit. L’Italie, morcelée en pouvoirs rivaux et bridée par de multiples contraintes, cherchait à sortir de son déclin en approfondissant la réflexion politique et juridique dans l’œuvre de ceux que Franco Venturi a si admirablement réhabilités sous le nom de «riformatori». La Russie entrait, non sans peine et non sans réticence, dans le nouveau contexte européen, où l’Espagne absolutiste faisait figure d’attardée, sinon d’ennemie, dénoncée d’ailleurs par son meilleur artiste, Goya.
Dans cet ensemble bigarré, la France apparaît alors comme le lieu par excellence où s’élaborent une civilisation originale, un art de vivre différent, une pensée sans cesse en mouvement. Cette fascination, qui s’accompagne parallèlement de préjuges anciens et d’expériences malheureuses, résiste même aux aléas de guerre et d’alliance. Dans les milieux les plus élevés de l’aristocratie anglaise, certains continuent à écrire en français, à le parler dans l’intimité et à se jeter sur les productions littéraires les plus récentes – qu’on songe aux fameuses sœurs Lennox, entichées de Voltaire autant que de Rousseau, à la relation de lord Bolingbroke avec Voltaire ou à celle de lord Shelburne avec Morellet. Il y a, dans cet engouement, peut-être une part de ce snobisme (la chose existe avant le mot), dont un auteur de théâtre français, Louis de Boissy, a fait la satire dès 1727 dans sa comédie Le Français à Londres. Mais le ridicule ne tue pas toujours, ni nécessairement.
La pratique de la langue française, plus répandue que celle de l’anglais dans l’Europe de l’époque, favorisera la pénétration de la pensée anglo-écossaise en lui servant de médiatrice. Dans un autre contexte, ce sera la très libre adaptation française donnée par l’abbé Morellet qui fera le succès européen du traité Dei delitti e delle pene de Beccaria.
Les classes dirigeantes de maints pays, principautés, duchés ou provinces ont le regard braqué sur Paris, la ville qui donne le ton, qui recèle toutes les audaces intellectuelles et où il semble que se prépare l’avenir. Le voyage à Paris est une obligation sociale pour les nobles anglais, allemands, scandinaves ou russes, mais il attire tout autant les artistes et les écrivains. Le russe Karamzine tombe en extase quand il arrive à cette capitale, «modèle du monde». Il s’écrie: «La voici! Je vais la voir! je vais y vivre!». L’abbé Galiani, attaché à l’ambassade de Naples à Paris, qui a noué des amitiés dans le monde des «philosophes», se sent exclu du paradis comme nos premiers parents lorsqu’il est rappelé dans son pays en 1769. Un roi tel que Frédéric II de Prusse versifie en français et ne dédaigne pas d’être le commensal de Voltaire, qu’il tient pour son maître à penser, ou du moins à écrire, encore qu’il se sente plus en sympathie avec un esprit moins brillant, mais qu’il juge plus solide, comme D’Alembert. La grande Catherine correspond avec Voltaire et elle invite chez elle le très hétérodoxe Diderot, quitte à le renier plus tard.
Les petits princes allemands ne sont pas les moins empressés à courtiser des auteurs français de moindre renom, qui orientent leurs lectures et forment leur goût. La superbe bibliothèque de la Grosse Landgrafin de Hesse-Darmstadt en témoigne éloquemment par la prépondérance des auteurs français contemporains. Dans ces conditions, le besoin se fait sentir très tôt d’avoir à Paris un correspondant attitré qui aura la charge de fournir régulièrement des nouvelles fraîches sur ce qui se fait, se dit, se voit ou s’entend dans la ville où bat le cœur de l’Europe intellectuelle.
Frédéric II entretient la première relation de ce genre à partir de 1736 avec le factotum de Voltaire, Thieriot, au tarif annuel de 1200 livres, payés irrégulièrement, car le roi n’est guère porté aux dépenses d’agrément. Thieriot est en quelque sorte son attaché culturel qui lui envoie les nouvelles littéraires, des livres, et aussi des marchandises, tout en lui servant d’intermédiaire avec le milieu des gens de lettres. L’abbé Raynal envoie des Nouvelles littéraires à Gotha, à Darmstadt et à Sarrebruck autour de 1747. La margrave de Bade-Durlach est informée des nouveautés parisiennes par une série de correspondants locaux à partir de 1757. La grande Catherine chargera plus tard La Harpe d’adresser une correspondance du même genre à son fils le grand-duc Paul. Suard correspond avec la margrave de Bayreuth, tandis qu’un consortium groupé autour de Pierre Rousseau, le directeur du Journal encyclopédique, communique avec la cour de Mannheim.
La majorité de ces «correspondants» appointés se contentent de fournir une information assez sèche, évitant de porter des jugements ou de manifester leur subjectivité. À cet égard, Raynal est le premier à donner à ses nouvelles un caractère personnel et un habillage attachant. Son rôle sera d’ailleurs déterminant, puisque c’est de ce modèle que procédera la Correspondance littéraire de Grimm.
Dans l’histoire des correspondances littéraires, celle de Grimm se distingue par plusieurs singularités. La première est qu’elle est l’œuvre d’un lettré allemand en quête d’une situation sociale. Fraîchement sorti de l’Université de Leipzig où il a eu pour maître le grand philologue Ernesti, il a d’abord tenté sa chance au théâtre, sans succès. Il est entré dès lors au service d’une famille noble en qualité de précepteur. Détail piquant et significatif, il devait enseigner à son élève le latin et l’allemand, le français étant la langue parlée dans ce milieu. Venu à Paris avec son jeune disciple en janvier 1749 en vue d’un séjour d’étude et de formation, il y restera jusqu’en 1792, si ce n’est pour des déplacements professionnels dans plusieurs pays européens. Dans le milieu bigarré des intellectuels sans emploi stable, si important et si nombreux à l’époque, il rencontre un autre étranger encore inconnu, Jean-Jacques Rousseau et – nouveau paradoxe – ils vont se lier d’amitié en raison de la proximité de leurs goûts musicaux. C’est d’ailleurs en lançant contre la musique française (Rameau mis à part) une vive critique, présentée sous la forme d’un pastiche du style biblique dans Le Petit prophète de Boehmischbroda, que Grimm connaîtra la notoriété, voire même une célébrité momentanée, en déclenchant la fameuse Querelle des Bouffons.
Autre singularité: Grimm exige de ses abonnés une discrétion absolue. C’est le prix à payer pour sa franchise et pour la liberté de ses opinions. La conséquence en sera le silence complet qui entourera la Correspondance en France jusqu’en 1812. Seule la confiance tardive accordée par les princes de Saxe-Gotha à certains écrivains de leur cour devait permettre à de grands auteurs allemands comme Goethe, Schiller et Herder de lire en manuscrit quelques-unes des œuvres les plus remarquables de Diderot que celui-ci, à l’exception du Neveu de Rameau, avait confiées au jeune Meister pour corser l’intérêt de la Correspondance. La pénétration foudroyante de Diderot en Allemagne est largement due à cette transmission discrète.
La liste des abonnés est tout aussi curieuse et révélatrice. Elle est l’œuvre patiente d’un Allemand bien introduit dans les petites cours d’outre-Rhin vivant à la française. Presque tous appartiennent à cette couche sociale. Le roi de Prusse, quant à lui, refusera de payer la somme réclamée pour quelques livraisons envoyées à l’essai. En revanche, la liste comprend un petit nombre de personnes du plus haut rang, comme Catherine II et la reine de Suède (sœur de Frédéric II) – toutes deux allemandes –, le duc Léopold de Toscane, frère de Joseph II et futur empereur, ainsi que le roi de Pologne Stanislas-Auguste Poniatow-ski, homme lettré certes, mais qui ne souscrivit peut-être que pour se conformer aux goûts de Catherine de Russie.
L’entrée de Grimm dans le monde des correspondances littéraires garde une part d’ombre, voire de mystère. Il s’est tout d’abord tourné vers les trois frères de Frédéric II, qui s’associèrent pour lui faire confiance, mais il n’obtint rien du roi. Les rapports avec la famille de Saxe-Gotha furent plus fructueux et bien plus durables. Ce petit noyau n’aurait cependant pas suffi à soutenir matériellement une carrière de journaliste. Raynal, qui avait précédé Grimm dans le métier de correspondant, s’était vu attribuer par le gouvernement la direction du Mercure de France et se trouvait ainsi matériellement à l’aise. Il se pourrait que l’amitié et la sympathie d’idées l’aient poussé à fondre discrètement son entreprise dans celle de son jeune ami, le soulageant ainsi d’un surcroît d’activités d’ailleurs assez similaires. Le lien entre les deux entreprises est en tout cas avéré, sans qu’on en connaisse exactement le mode opératoire.
Au fil des années, la tâche de Grimm va s’alourdir du fait même qu’il se trouve de plus en plus couvert de titres et de fonctions auprès des petites cours, et surtout des grandes. Vers la fin de l’Ancien régime, il est devenu le représentant personnel de Catherine II en France. Son goût des honneurs et sa dévotion envers les puissants l’ont éloigné petit à petit de Diderot, au point que celui-ci se fâche et s’écrie en mars 1781: «Mon ami, vous avez la gangrène [...] Vous êtes devenu le plus dangereux des anti-philosophes». La rupture entre les deux hommes est alors consommée. Il est vrai que le gestion de la Correspondance littéraire était alors passée à Meister depuis 1773.
La longue pratique du secret avait amené le responsable de la Correspondance littéraire à se montrer à la fois exigeant et sincère dans sa critique. Certains de ses jugements à l’emporte-pièce n’en sont que plus cinglants dans leur brièveté. Qu’on en juge par ces deux exemples. Un M. de Boissy fils avait publié une histoire du poète grec Simonide et de son siècle. Grimm l’exécute en quelques lignes qui aboutissent à une conclusion inattendue sous sa plume: «C’est une compilation fort ennuyeuse, et un fatras d’érudition et de citations, fait dans le goût des érudits d’Allemagne». Que l’auteur soit un médecin ordinaire du roi ne rend pas le censeur plus indulgent: «L’Idée de l’homme physique et moral est un fort mauvais livre de M. La Caze, docteur de la faculté de Paris, obscur, mal fait, et n’ayant pas trop le sens commun. Malheureusement il doit servir d’introduction à un traité de médecine qui suivra, si Dieu n’y met ordre».
En revanche, les sympathies personnelles de Grimm et de ses collaborateurs occasionnels transparaissent fortement dans leur critique. C’est le cas par excellence dans le compte rendu des Pensées sur l’interprétation de la nature de Diderot, ouvrage mal reçu en général par la presse et dont Grimm souligne au contraire, avec un sens esthétique remarquable, la beauté formelle et les élans lyriques. Cette sensibilité se manifeste également dans les comptes rendus des Salons de peinture, où Diderot reprendra la méthode d’analyse suivie par Grimm, mais en la libérant et en l’ouvrant sur l’imaginaire. L’indépendance intellectuelle de Grimm est manifeste dans certains de ses jugements sur la production des vedettes de l’époque, qu’il s’agisse de Crébillon fils, du philosophe Condillac et même de Voltaire, lorsque celui-ci manifeste trop de complaisance envers ses amis et ses protecteurs. Le souci dominant du journaliste sera de brosser le tableau de l’ensemble du monde des arts, des lettres et de la scène ainsi que de l’actualité de la vie intellectuelle telle qu’elle s’exprime sous de multiples formes, entre autres à l’Opéra. Ce tableau embrasse l’essentiel de la vie intense d’une époque qui vit la France rayonner sur l’Europe et fasciner même ses adversaires politiques.
Que quelques-uns des abonnés de la Correspondance littéraire lui soient restés fidèles jusqu’en 1813, au-delà des guerres de la Révolution et de l’Empire, est la preuve de la qualité de l’ouvrage et de la satisfaction de ses lecteurs. L’édition imprimée, lancée dès 1812 par l’éditeur Buisson, rendra la Correspondance littéraire accessible au public. Ainsi se prolongera et se maintiendra, à travers des versions plus ou moins aménagées et arrangées, l’impact de ce qui reste le monument d’une grande civilisation.
À ce titre, la Correspondance littéraire méritait incontestablement d’être republiée et connue enfin sous sa forme la plus complète, la plus sûre et la mieux documentée. Les responsables de cette audacieuse entreprise se sont adressés aux meilleurs connaisseurs de la presse et de la production intellectuelle du XVIIIe siècle, non seulement en matière littéraire, mais également en économie, en sciences naturelles, en philosophie, en histoire, en musique, en peinture, en pédagogie – y compris celle des princes. Leur érudition impeccable nous restitue toute l’époque dans sa prodigieuse diversité et rend une jeunesse nouvelle aux œuvres consacrées par le temps et que nous découvrons dans leur fraîcheur. Au fur et à mesure que nous entrons ainsi dans l’actualité du siècle, nous nous en sentons un peu contemporains et notre échelle des valeurs s’en trouve plus nuancée et plus complexe. En associant le plaisir au savoir, le dépaysement à la découverte, cette œuvre monumentale s’offre à notre lecture comme le témoignage fidèle d’un siècle qui s’est consacré aux formes les plus subtiles de «l’art de jouir».

